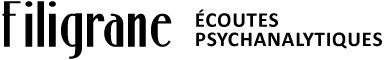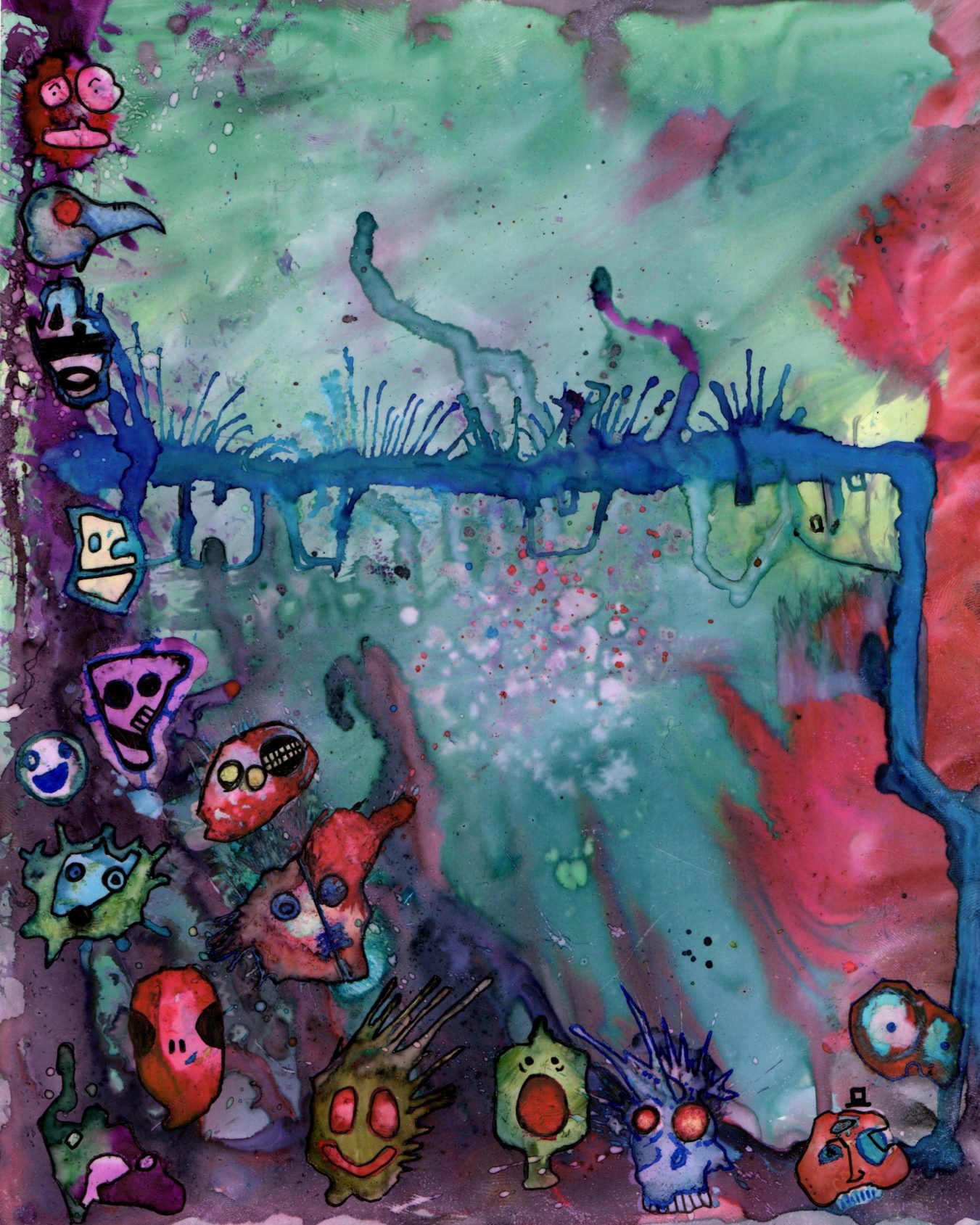Autour de l’exemple de Jean-Claude Romand, un Français ayant réussi à se faire passer pour un médecin chercheur à l’Organisation mondiale de la santé pendant plus de dix-huit ans, ce texte interroge les logiques inconscientes conduisant certains individus à ériger le mensonge en véritable manière d’être. Il est montré que, contrairement à ce qui a pu être écrit, lesdits « mythomanes » ne croient pas à leurs mensonges. Seuls leurs auditeurs y adhèreraient. Le sujet leur propose à cette fin un discours qui entre en résonance avec leurs attentes. Or, cette faculté à saisir ce que les autres désirent pour s’attirer leurs faveurs interroge. La capacité d’empathie extrême, quasi surhumaine, qui caractérise le fonctionnement psychique de ces sujets, apparaît comme étant le corollaire d’une immense précarité psychique. Totalement dépendants du lien à autrui, leur « talent » relationnel témoigne de l’existence d’une problématique narcissique aussi sévère qu’imperceptible. En retour, le mensonge, conçu comme un mécanisme de défense, les préserverait de la menace fantasmatique que leur ferait vivre un lien, dont ils auraient à la fois tout à attendre et tout à redouter.
Cet article traite de l’écoute du mensonge dans la clinique des psychoses. Nous partons de l’hypothèse selon laquelle beaucoup de paroles fausses qui nous sont adressées dans ce contexte ne s’inscrivent pas dans un registre mensonger. Pourtant, certains patients sont considérés à tort comme des menteurs au sein des institutions de soin, avec tous les effets délétères que cela implique. Après nous être interrogés sur les conditions de possibilité du mensonge en croisant les apports de la psychanalyse, de la philosophie du langage ordinaire et des actes de langage perlocutoires, nous illustrerons la pertinence clinique de notre démarche.
Ce texte met en question le caractère de véracité des sentiments transférentiels et en particulier l’amour de transfert, en déployant deux conceptions de l’inconscient et de ce qui induit le transfert, soit celle de Freud et celle de Laplanche. Ces conceptions qui ne s’excluent pas mettent l’accent sur ce qui vient de l’analysant et ce qui vient de l’analyste. Vrai et faux, les phénomènes transférentiels appartiennent à la réalité psychique, c’est-à-dire le noyau dur de l’inconscient. La position de pouvoir de l’analyste doit d’autant être neutralisée que ce qui émane de son inconscient en tant que signifiants énigmatiques reproduit la situation de séduction originaire. Répondre au transfert est une forme d’abus de pouvoir, alors que l’exigence éthique est d’« en » répondre, et non pas d’« y » répondre ; répondre donc de ce qui est en train de se passer, répondre de ce qui est interprétable, et ce tout autant quand on se trouve dans des situations apparemment non sexualisées, quand on a affaire au vide maternel, ou encore à la haine, à la destruction ou au négatif sous toutes ses formes, silencieuses ou non.
Cette contribution envisage les modalités de traitement psychanalytique de personnes atteintes par les problématiques complotistes. La distinction entre psychothérapie et psychanalyse dégage l’intersubjectivité entre le patient et le clinicien comme propédeutique à un jugement rationnel. Le cas de la patiente Mathilde éclaire une défense paranoïaque-perverse non encore figée en structure et donc susceptible d’évoluer. Le cas d’Alexandre est exemplaire d’un trouble archaïque infantile qui ressurgit à l’adolescence dans un sentiment de fausseté et de persécution. La question de nos valeurs se pose au-delà de l’opposition du vrai et du faux.
La psychanalyse peut éclairer le partage entre le vrai et le faux dans le social à partir de ce qui est juste dans l’interprétation en séance. Le fake selon Donald Trump et d’autres, la post-vérité, les « faits alternatifs », relèvent d’une confusion qui n’est pas exactement le mensonge. Une image photographique peut être vue de plusieurs façons et certains historiens distinguent mal la fiction de la véracité dans le contexte d’une domination des discours relativistes. Dans cette nouvelle rhétorique sophiste insistent les invariants paranoïaques-pervers à l’œuvre dans le discours nazi. Les conceptions freudiennes sur le déni, la psychose et les phénomènes de masse s’appliquent aux années 1930-1945 mais aussi au complotisme contemporain, avec une différence : désormais la logique totalitaire se dilue dans une crise démocratique de l’autorité. Les vérités sont partielles et améliorables dans une perspective laïque, tandis que les religions comportent un versant dogmatique et un versant ouvert au commentaire. Un optimisme pondéré caractérise la nécessaire défense d’un rationalisme renouvelé.
L’identité personnelle de tout un chacun est forcément multiple et métisse, à l’image de nos sociétés globalisées. Par les flux incessants auxquels elle soumet les individus, notre époque postmoderne favorise la multiplicité et l’émergence d’un soi pluriel. Les réseaux sociaux, brouillant les limites entre le réel et le virtuel, permettent aussi de se construire de nouvelles identités et de vivre des facettes cachées de sa personnalité. L’analyse détaillée de la situation clinique d’une patiente présentant un trouble de l’identité et une forme de dysphorie du genre issus de sa relation primaire avec sa mère me permet d’étudier l’extrême complexité de la construction psychique de la féminité chez la femme et ses liens avec la maternité, et de souligner au passage les limites de l’approche des gender studies pour expliquer la genèse de l’identité sexuée et ses embûches. Les gender studies ne tiennent compte ni de l’histoire singulière du sujet ni de sa fantasmatique personnelle autour du corps, dont les origines se situent dans la relation primaire à la mère.
***
The personal identity of everyone is necessarily multifaceted and hybrid, just like the globalized society we live in. In our postmodern era, every individual is submitted to constant flows which promote the multiplicity and the development of a plural self. The social networks, by blurring the frontiers between the real and the virtual, make it possible for individuals to build new identities and to experience hidden aspects of their own personality. I make a comprehensive analysis of a clinical vignette of a patient suffering from an identity trouble and a kind of gender dysphoria as the result of the primary relationship with her mother. I study the very complex psychic construction of the femininity in women, in relation- ship with motherhood. Thereby, I argue that the gender theory cannot explain the origin, riddled with obstacles, of the sexual identity, because it doesn’t take into account neither the unique history nor the personal body fantasies of each person, whose origins lay in the primary relationship with the mother.
À propos de Filigrane
CHAQUE ANNÉE UN THÈME D'ACTUALITÉ EST ABORDÉ DANS LE DOSSIER, RÉPARTI AU SEIN DE DEUX NUMÉROS