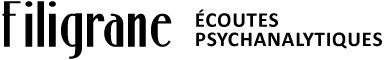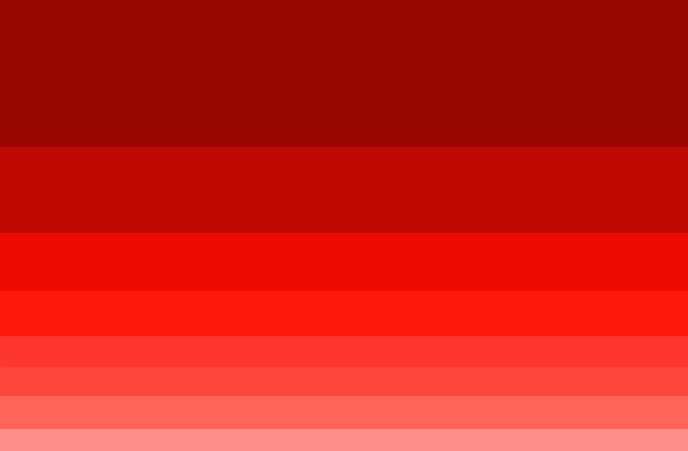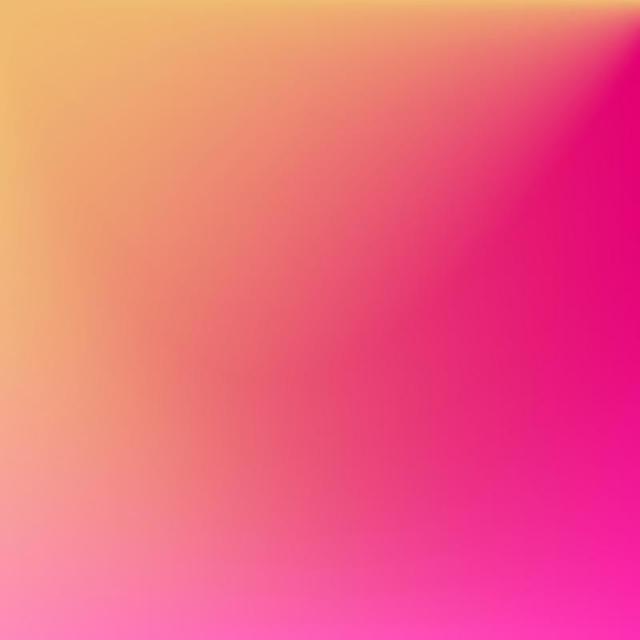L’auteure, clinicienne d’orientation psychanalytique, raconte comment la lecture de La guerre des tuques l’a rapprochée d’une énigme concernant le sexuel infantile, énigme également convoquée par la rencontre analytique avec les enfants. Nourrie d’une vignette clinique, cette expérience a inspiré une rêverie donnant lieu à une réflexion sur le travail analytique auprès des enfants, plus particulièrement sur le rapport entre les générations, la relation face à l’infantile en soi et chez l’autre, ainsi que la relation transférentielle – autant de bases à cette rêverie qui cherche davantage à ouvrir des réflexions qu’à trouver des réponses.
Après avoir rappelé la tentative de réaménagement psychique que peut représenter le recours à l’acte de fuguer, cet article propose une lecture de la trajectoire adolescente marquée par ce type d’expérience. La psychothérapie de Sophie, qui s’est déroulée sur une quinzaine d’années, autorise une observation en après-coup d’une trajectoire de fugue adolescente. Il pourrait être tentant de parler ici d’une forme de résilience. Toutefois, il apparait plus juste d’évoquer l’accès à une « relativement bonne adaptation sociale » sur des personnalités restées en souffrance, au bord de décompensations, au-delà de leur adaptation. La discussion porte sur les effets positifs ou délétères d’un tel recours à l’acte, en insistant sur la différence fugue/errance ainsi que sur l’intérêt de la psychothérapie d’inspiration analytique dans l’après-coup de tels contextes extrêmes, à forte occurrence limite.
Cet article propose une relecture du cas de l’Homme aux rats (Freud, 1915) dans le but d’éclairer le clinicien aux prises avec la symptomatologie de la névrose obsessionnelle. Cette catégorie diagnostique et nosographique aujourd’hui un peu délaissée au profit des troubles de personnalité, des états limites, de la perversion narcissique et surtout de la psychopathologie vue sous l’angle du DSM, est pourtant encore très présente dans la pratique. Sa symptomatologie tortueuse et complexe peut laisser le thérapeute dans le désarroi : alternance infernale de pulsions contradictoires, ressassement, cogitations, incapacité d’accéder au compromis, doute généralisé, comportements marqués par l’annulation rétroactive… Ces patients tentant sans relâche de concilier l’irréconciliable ont vite fait d’égarer l’intervention dans les dédales de leurs défenses. Cette contribution cherche, en retraçant pas à pas les méandres complexes et parfois opaques de l’histoire de l’Homme aux rats, à aider le clinicien aux prises avec un transfert, des associations et des symptômes à la fois typiques et confus.
Cet article introduit et discute les concepts théoriques clés de deuil développemental et de conflit de la parentalité se rapportant aux psychothérapies mères-bébés élaborées par Bertrand Cramer et Francisco Palacio-Espasa. La présentation d’un cas clinique permet de les articuler en lien avec les processus psychiques et les interactions observés chez une mère et son bébé.
Le dessin est une expression graphique des capacités de représentation mentale de l’enfant. À travers ses dessins, l’enfant exprime ses craintes, ses angoisses et ses satisfactions de façon symbolique. L’emploi des dessins en contexte de psychothérapie s’avère particulièrement pertinent lorsque l’enfant utilise peu ou pas la parole pour s’exprimer. Le dessin permet d’établir un langage entre l’objet (contenu du dessin), le sujet (enfant) et l’observateur (psychologue), tout en offrant un support visuel sur lequel l’enfant peut coucher son monde fantasmatique. Ce dernier devient ainsi réel et tangible, sans pour autant représenter la réalité concrète de l’enfant. Cet article vise à montrer, à l’aide de quelques exemples, l’usage pouvant être fait des dessins dans les contextes d’une évaluation psychologique et d’une psychothérapie. Les dessins d’un jeune présentant des vulnérabilités de nature psychotique sont présentés et discutés à la lumière des éléments historiques et contextuels, des conflits intrapsychiques, des angoisses et des ressources psychologiques de l’enfant. Les auteurs illustrent également le travail thérapeutique réalisé autour des angoisses archaïques de morcellement, d’anéantissement et de persécution qui se sont manifestées massivement dans le transfert de l’enfant. Des considérations théoriques et cliniques relatives à la psychothérapie d’enfants présentant une organisation de la personnalité psychotique sont aussi exposées.
Alors que l’interdit du toucher est au centre du dispositif psychanalytique, le travail thérapeutique avec des adolescents remobilise de manière singulière la conceptualisation du cadre et du processus. Que dire alors du moment où la thérapeute est enceinte? La question du corps est au cœur du travail de subjectivation, à la fois sous ses aspects sensoriels et sous ses aspects génitaux. C’est ce que nous travaillerons avec le déroulement de la thérapie d’une jeune adolescente, Mila, chez qui l’image du corps est fragile, attaquée, du dehors et du dedans. Elle le mettra en acte en se mettant en danger, en se marquant le corps par des maquillages, des piercings et par des tenues ambigües quant au genre, des tenues d’animaux… Dessinant beaucoup pendant les séances, nous pourrons étudier les mouvements projectifs de son image du corps ainsi que les éléments sensoriels et sensuels contenus dans le contact avec la feuille. Durant sa thérapie, le fait que j’ai été enceinte a remobilisé chez elle des ancrages archaïques qui lui ont permis de retravailler la constitution de son enveloppe psychique bisexuée. L’attention portée à un corps invisible mais présent engagea un travail hallucinatoire, au sens d’un travail du rêve qui s’est traduit par un rêve rapporté en séance et qui se répètera de manière signifiante au cours de sa thérapie, à une date anniversaire. De même, nous penserons à l’effet révélateur, à l’occasion de mon arrêt, de confusions précoces entre les enveloppes psychiques de la mère et de la jeune fille.
***
While the prohibition of touch is at the center of the psychoanalytic device, the therapeutic work with adolescents singularly remobilizes the conceptualization of its framework and process. What to say then when the therapist is pregnant? The question of the body is at the heart of the work of subjectivation, both in its sensory and genital aspects. This is what we will work on in this paper by analyzing the course of a therapy with a young teenager, Mila, in whom the image of the body is fragile, attacked from outside and from within. She will put it into action by putting herself in danger, by marking the body with make-up, piercings and presentations of outfits that are ambiguous as to the gender, animal outfits, etc. Since she was drawing a lot during the sessions, we were able to study the projective movements of her image of the body as well as sensory and sensory elements contained in the contact with the paper. During her therapy, the fact that I was pregnant remobilized her archaic anchors and allowed her to rework the constitution of her bisexual psychic envelope. The attention paid to an invisible but present body led to a hallucinatory work, in the sense of a dream work that resulted in a dream reported in a session and repeated in a significant way during her therapy, on an anniversary date. In the same way, we will think about the revealing effect, at the time of my maternity leave, of early confusions between the psychic envelopes of the mother and the girl.
À propos de Filigrane
CHAQUE ANNÉE UN THÈME D'ACTUALITÉ EST ABORDÉ DANS LE DOSSIER, RÉPARTI AU SEIN DE DEUX NUMÉROS