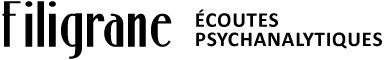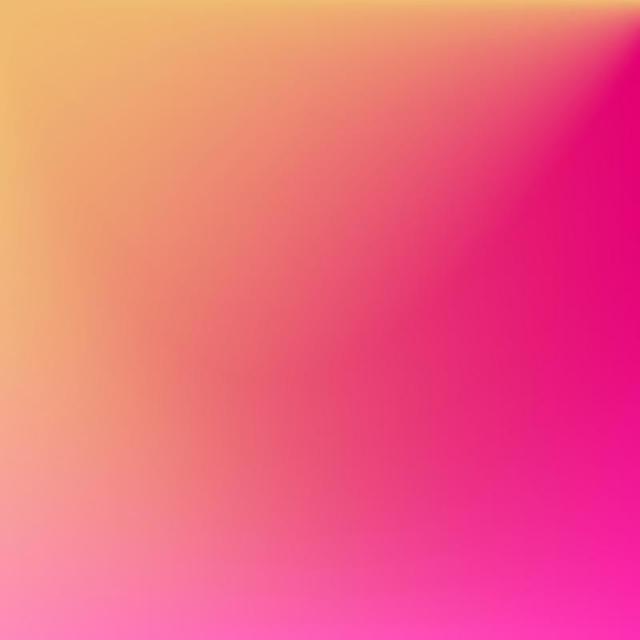La pratique préventive de la Maison buissonnière, qui reçoit à Montréal depuis une trentaine d’années des bébés et des enfants d’âge pré-œdipien accom- pagnés de leurs proches, se situe toujours hors des sentiers battus, autant des pratiques psychanalytiques courantes que des pratiques socio-éducatives préva- lentes au Québec. Adossé sur les enseignements de Françoise Dolto et sur les théo- ries du développement précoce, l’accueil de familles vise que le bébé ou le petit enfant puisse « dérouler sa question » et que le parent puisse l’entendre, afin que les malentendus entre lui et sa famille ne se nouent pas ultérieurement en symp- tômes. L’article décrit les principes qui soutiennent le travail des «accueillants», les illustre par des exemples tirés de la pratique au quotidien et présente quelques- unes de ses bases théoriques.
Cet article traite du cadre conçu et proposé par une clinique psychana- lytique socialement impliquée, offerte dans l’espace urbain de la ville de Brasília, capitale du Brésil. Cette expérience a posé le défi de repenser le cadre en fonction des spécificités de la rue et de la souffrance sociopolitique des sujets qui la fré- quentent ou qui y vivent. La proposition consistait à offrir une écoute dans un espace où l’imprévisibilité fait partie intégrante du scénario lui-même: face aux incertitudes de l’espace urbain, le collectif Psychanalyse dans la rue a élaboré un cadre possible pour une clinique urbaine ayant des garanties de support et de fiabilité. Afin d’analyser les enjeux et les dispositifs de ce cadre, la méthodologie adoptée par cet article repose sur l’analyse de thèmes relevés dans des entretiens semi-directifs réalisés avec cinq analystes du collectif. Dans ce contexte, la notion de « cadre intérieur » de l’analyste s’est avérée cruciale, puisque la psychanalyse en dehors de son cadre classique exige de l’analyste qu’il conjugue avec des frontières spatiales, corporelles et sensorielles qui ne sont pas toujours clairement définies, tout en tenant compte de la particularité de la dynamique transférentielle et de sa dimension multifocale, en raison notamment de la rotation possible des analystes auprès des patients écoutés
La pandémie de COVID-19 a été un ébranlement narcissique qui a révélé la face cachée du moi, de même que celle du cadre analytique. Le passage à un cadre de travail à distance a ouvert un laboratoire qui permet d’interroger non seulement les conséquences, mais aussi les fondements de tout cadre analytique. Avec Bleger et Donnet, l’enjeu des processus ouvre une perspective permettant d’appréhender le cadre quant à son action sur le travail de symbolisation. Les effets du cadre à distance sur les phénomènes cliniques gagnent ainsi à être articulés avec le cadre symbolique interne de chaque patient.
Les auteurs présentent une expérience de psychothérapie de groupe avec des enfants développée depuis une quinzaine d’années dans le réseau public de santé (hôpital et CLSC) et dans le réseau communautaire. Après en avoir pré- cisé les indications, notamment au niveau de l’hétérogénéité des diagnostics, le modèle du dispositif groupal est défini. Les angoisses liées à la mise en groupe, le groupe comme objet, l’illusion groupale, l’élaboration des différences, la non-satu- ration de sens, l’excitation et le groupe de soutien à la parentalité sont discutés et illustrés par des vignettes cliniques.
Les « cadres » du travail psychanalytique ont évolué, du fait de contraintes externes (sociales, politiques) et internes (représentations des effets et des processus de changement dans le travail de soin psychique). On peut néanmoins rester psy- chanalyste dans ces dispositifs pluriels : la psychanalyse ne se résume pas à sa praxis. On peut soutenir ainsi l’équivalence entre les termes «psychanalyse» et «psycho- thérapie psychanalytique»: la «psychothérapie psychanalytique» est le nom de la psychanalyse ajustée à la réalité – clinique et sociale – des patients. Quel que soit le dispositif (cure-type ou autre), les fondements de la position clinique psycha- nalytique sont identiques. La position psychanalytique est par ailleurs toujours ouverte et correspond à une position fondamentalement « transdisciplinaire ». Une telle position est centrée sur l’essentiel de la relation soignante, qui ne doit pas être confondu avec ses artifices et qui transcende les conditions spécifiques des dispo- sitifs singuliers. L’approche transdisciplinaire, dans le soin psychique, suppose un « partage » de la fonction soignante. La parentalité est un paradigme de la transdisci- plinarité, et la parentalité est toujours une « parentalité soignante », car elle consiste à prendre soin de l’enfant ou des aspects infantiles des sujets dont on s’occupe. Elle est ainsi un «invariant transdisciplinaire». La position psychanalytique est, enfin, une position politique. La psychanalyse a une fonction politique ; elle est garante de la prise en compte de la subjectivité. Le psychanalyste doit tenir compte des réalités du corps comme des réalités sociales, notamment politiques. Les ajustements de la pratique psychanalytique sont souvent une réponse aux contraintes politiques et représentent eux-mêmes un acte politique.
La réponse au nombre croissant de patients qui consultent pour des problématiques psychothérapeutiques sévères et pour qui la cure-type n’est pas indiquée aura pris la forme d’aménagements du dispositif-cadre de soin. Prendre en considération le cadre inscrit dans la transitionnalité proposé à ces patients permettra de réfléchir tant aux impacts que ces remaniements ne sont pas sans entrainer qu’au potentiel thérapeutique que ceux-ci présentent. On verra com- ment des approches psychanalytiques qui ne sont pas entièrement vectorisées par le langage, notamment la psychothérapie à médiation artistique, sont suscep- tibles, grâce à leur pouvoir d’objectivation et leur capacité à rendre figurable, de « faire apparaître [le] conflit au dehors, de manière à en permettre une introjection secondaire » (Baldacci, 2010). Il sera également question de reconnaître ce que le cadre thérapeutique réinventé doit aux patients eux-mêmes (Birot, 2018) et la dis- position du psychothérapeute à l’instaurer, ce qui, dans le contexte de la médiation artistique, ne saurait advenir que par la prise en considération de la figurabilité de l’image dans sa double valence, à la fois matérielle et psychique.
À propos de Filigrane
CHAQUE ANNÉE UN THÈME D'ACTUALITÉ EST ABORDÉ DANS LE DOSSIER, RÉPARTI AU SEIN DE DEUX NUMÉROS