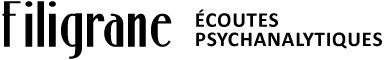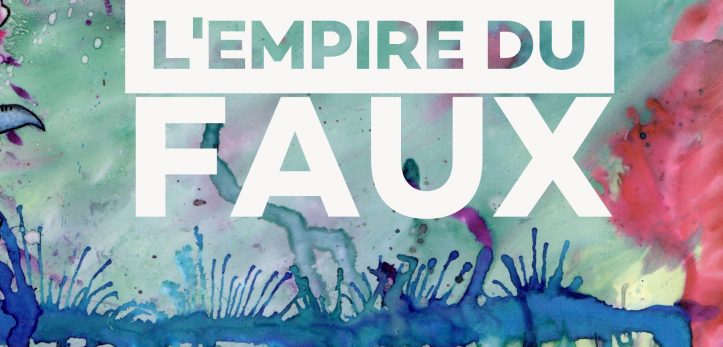
L’empire du faux – Première partie
Volume 29
Partie 1
Ce numéro débute par le premier volet du dossier « L’empire du faux », thématique au cœur de notre plus récent colloque, tenu à l’automne 2019. L’argumentaire à l’origine de l’événement, et qui figure en guise d’introduction, expose quelques-unes des nombreuses ramifications du faux, en allant des questions ontologiques aux enjeux épistémologiques, en passant par les phénomènes de désaveu, de dissimulation et de désinformation, sans oublier la « vérité » des patients, que celle-ci soit ou non sciemment voilée.
Le dossier prend son envol avec deux articles de François Richard, tête d’affiche du colloque. Dans le premier, Fabrication du mensonge, l’auteur s’attarde aux fondements paranoïaques-pervers du complotisme tel qu’on le retrouve dans notre culture contemporaine. Il en ressort le constat troublant d’une profonde crise de l’autorité, qu’elle soit politique, religieuse ou autre. Dans le second, Psychanalyse du faux, François Richard partage son expérience du traitement de personnes présentant des problématiques complotistes. Il insiste notamment sur la déstabilisation du thérapeute face à de tels patients, laquelle, conséquemment, compromet la capacité à fournir un accueil neutre et bienveillant à ces derniers.
Par la suite, Élyse Michon, elle aussi conférencière de notre colloque, nous transporte dans les remous tumultueux des rapports transférentiels et contre-transférentiels. Son texte, Le transfert. Le vrai, le faux et l’illusion véridique, traite entre autres du caractère de véracité de l’amour de transfert, sujet rarement discuté de par les tabous qui l’accompagnent. L’auteure met en perspective la conception de Freud et celle de Laplanche quant à l’inconscient et ce qui induit le transfert. Elle souligne l’exigence éthique qui incombe à l’analyste face à un possible abus de pouvoir.
Pour clore ce dossier thématique, Étienne Pelletier offre une réflexion intitulée D’un dire faux qui ne serait pas du mensonge. Mentir et se faire mentir à la lumière de la clinique des psychoses. L’auteur nous amène à réfléchir aux extrémités de la parole – sa racine et son effet – en illustrant la dichotomie possible entre les deux. Éviter de déduire la présence d’une intention mensongère constitue non seulement une nécessité clinique et éthique, mais aussi un défi de taille lorsque la personne qui écoute se sent délibérément trompée.
La rubrique Hétéros s’ouvre sur Le dessin et la psychothérapie d’enfants présentant des vulnérabilités de nature psychotique : illustration clinique, texte de Miguel M. Terradas, Antoine Asselin et David Poulin-Latulippe. Le dessin y apparaît comme l’assise d’un langage d’une grande valeur puisqu’il permet la liaison entre le contenu graphique, l’enfant et le thérapeute, palliant ainsi les difficultés d’élaboration par la parole. Au moyen d’exemples tirés de la clinique, l’usage pouvant être fait des dessins d’enfants dans le cadre d’une évaluation et d’une psychothérapie est décrit.
Mères-bébés : une histoire à co-construire, de Valérie Lamontagne, vient compléter la présente rubrique en discutant de concepts théoriques en lien avec le deuil développemental et le conflit de la parentalité se rapportant aux psychothérapies mères-bébés, telles qu’élaborées par Bertrand Cramer et Francisco Palacio-Espasa. La présentation d’un cas clinique étaye le propos.
Dans la rubrique Psychanalyse à l’université figure Le traumatisme psychique d’une naissance prématurée chez l’enfant : une revue de littérature réflexive, de Mélissa Lord-Gauthier. Cette dernière met en évidence le rôle possible du traumatisme de la naissance et de l’hospitalisation dans la survenue de séquelles neurodéveloppementales. Elle discute également des interventions qui visent à atténuer les effets nuisibles de ce traumatisme.
Le présent numéro se termine par une recension de l’ouvrage de Francis Levasseur, L’espace de la relation : essai sur les bureaux de psychologue, paru cette année aux éditions Varia. Véronique Lussier souligne notamment l’originalité de la réflexion de l’auteur et de sa démarche, alors que le sujet du cadre spatial est pourtant au nombre des composantes essentielles du travail clinique.