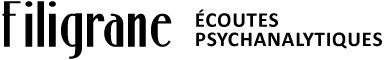Psychanalyse et temporalités
Volume 22
Partie 1
par Sophie Gilbert et Véronique Lussier
Cette année, Filigrane propose deux numéros sur le thème de la temporalité, telle que la psychanalyse nous en dévoile l’importance dans la cure, mais aussi, dans la compréhension du fonctionnement psychique. Indirectement, puisque le temps ne constitue pas un concept fondamentalement psychanalytique, la théorie psychanalytique permet d’entrevoir néanmoins l’omniprésence de cette notion, à tout le moins d’une temporalité psychique fondatrice du fonctionnement (psychique, mais aussi social) du sujet : la temporalité de l’après-coup, de l’actuel, celle du rythme développemental (dans les stades, les positions, et même les niveaux de représentation/symbolisation), celle abolie par le fonctionnement inconscient.
Incontournable, donc, en psychanalyse, la notion de temporalité peut être abordée sous différents angles, comme nous le démontrent nos auteurs : nouvelles perspectives pour l’intervention, compréhensions novatrices de la spécificité du travail psychanalytique, tel est le riche menu de ce premier numéro thématique de l’année.
La référence à la temporalité éclaire ainsi la clinique du traumatisme, du deuil, etc., mais aussi, l’entendement du développement humain —de l’originaire à la mort, en passant par l’autonomisation relative au passage à l’âge adulte. De plus, la spécificité du travail psychique dans un dispositif psychanalytique ne saurait faire l’économie d’une fine compréhension de la temporalité propre à la formation du symptôme et du rêve, notamment, de même que des différentes figurations du temps dans l’interprétation, la traduction, voire la butée de ces composantes essentielles du travail propre au clinicien d’orientation psychanalytique.
Pour inaugurer ce dossier, Nicolas Peraldi aborde la dualité d’une temporalité considérée au regard de deux mouvements distincts qui la constitue : Chronos et Kairos. En référence à ces concepts émanant de la Grèce Antique, ce point de vue original lui permettra de discuter puis d’illustrer l’accordage possible mais toujours houleux entre les dimensions sociales et psychiques d’un suivi auprès de jeunes en difficulté, fraîchement issus des services de protection de l’enfance, à l’orée d’un passage trop souvent entravé vers une inscription sociale, mais aussi d’un travail d’autonomisation et surtout, de subjectivation adulte.
Par la suite, dans une écriture à la fois limpide et didactique, Dominique Scarfone expose une compréhension de la temporalité en suivant le fil conducteur des entendements philosophiques et métapsychologiques de la perception, de même que celui du paradoxe de l’inconscient hors temps. Au fil des paragraphes, les lecteurs pourront démystifier autant de notions complexes telles la Chose, l’Actuel, ou même, le Sexuel. En découle une vision fort pertinente du travail psychanalytique, notamment du rôle de l’analyste dans la traduction qui ne saurait faire l’économie d’un rapport « déictique », et qui ne peut que se poursuivre au fil du temps, un temps à la fois toujours relatif à un certain originaire, mais paradoxalement, à jamais inachevé.
L’élaboration par Louise Pepin du concept de la trace poursuit, sous un autre angle, la question de l’intemporalité de l’inconscient. L’auteure revisite pour nous les conceptions freudiennes des formations de l’inconscient, du souvenir et de l’après-coup, dans une élaboration illustrée d’extraits cliniques. Comme un refrain, la butée de toute analyse, de tout travail d’interprétation, de représentation et plus largement de symbolisation se dévoile, en termes de l’inaccessibilité (ou l’inconnu) du réel, du traumatisme originaire, de l’ombilic du rêve. Particulièrement originale est la mise au travail de cette notion de trace, par l’auteure, dans le domaine de la création artistique.
Pour clore cette première partie du dossier, Marc Bonnet aborde la thématique de la temporalité par le biais des limites originaires et mortifères de celle-ci. Dans une riche élaboration théorique, il nous expose ce passage subjectif qui caractérise tout individu, tout en l’inscrivant dans le social et plus encore, dans le destin de l’humanité. Cet abord singulier de la temporalité s’avère particulièrement pertinent de par ses éclairages psychopathologiques et cliniques, en parallèle à des résonances spirituelles et anthropologiques.
Ce numéro s’achève avec la rubrique Heteros, par un article où Bernard Brusset traite de la question à la fois actuelle et controversée de la supervision des psychanalystes. Ce faisant, l’auteur démystifie les enjeux inhérents à cette pratique dans ses dimensions institutionnelles, certes, mais également, par extension, dans ses fondements et sa légitimité propres. Cet article interpelle à la fois les psychanalystes et leurs institutions d’appartenance, mais aussi les enjeux plus personnels relatifs à la personne du superviseur et du supervisé. Au passage, le lecteur pourra éclaircir certains aspects fondamentaux de la distinction entre cure et psychothérapie psychanalytique, et le délicat passage de l’une à l’autre dans l’approche du client/analysant.
Dans notre rubrique Entretiens, nous avons le plaisir de publier la version écrite de deux entretiens menés à Montréal, à l’occasion du passage en 2012 de Mesdames Danielle Quinodoz et Christine Anzieu Premmereur au Congrès annuel de la Société canadienne de psychanalyse [1]. Par un curieux hasard, ces deux psychanalystes ont choisi d’aborder respectivement les thématiques du vieillissement et des relations précoces mère-nourrisson, ce qui conclut de façon fort à propos notre dossier sur la temporalité.