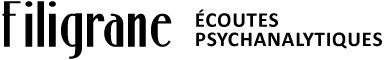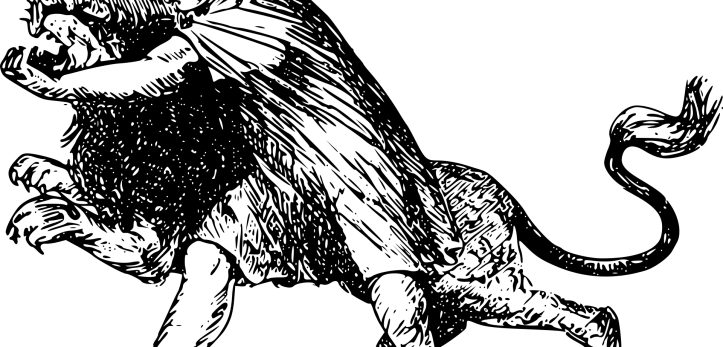
Le sujet de la violence
Volume 25
Partie 2
Ce numéro de la revue Filigrane comporte la seconde partie de notre dos- sier consacré à la violence et au sujet. De nouveau, cette thématique fera place à une diversité d’auteurs et de points de vue sur ce large thème. En effet, les cliniciens ne peuvent faire abstraction de la culture et de l’époque dans lesquelles s’enracine leur pratique. L’omniprésence de la violence — au sein de certaines psychopathologies, de même qu’associée au contexte socio- culturel entourant celles-ci — a des répercussions sur leur travail clinique. Ce faisant, qu’il s’agisse de considérer les assises métapsychologiques de la violence et de revenir aux fondements constitutifs du sujet, ou à l’opposé, de prendre en compte les enjeux socioculturels et politiques dans lesquels s’inscrivent l’actualité d’une violence extrême et l’« homme nouveau » qui la révèle, le clinicien sera amené à remettre en chantier des savoirs sans cesse modelés par l’espace-temps dans lequel ils se déploient.
Le dossier thématique s’amorce par un article de Louis Brunet qui situe d’abord la violence en regard de ses assises développementales, du point de vue métapsychologique. Puis, l’auteur analyse différents cas de figure de la violence agie, de la criminalité locale au terrorisme à l’échelle mondiale.
Alexandre L’Archevêque et Élise Bourgois-Guérin abordent le second point d’ancrage de ce dossier, par une analyse à la fois sociétale et indivi- duelle du sujet. La réflexion des auteurs amène le lecteur à reconsidérer l’articulation corps-esprit dans la constitution du sujet, afin d’en arriver à cerner la posture de celui-ci dans la relation psychothérapique, notamment sous l’angle original de la « croyance ».
Les trois articles suivants témoignent d’expériences personnelles de cli- niciens sensibles, voire confrontés à la violence inhérente au terrorisme et aux conflits armés.
D’abord, Francis Maqueda nous convie ni plus ni moins qu’à un voyage humanitaire, clairement situé dans le mondialisme et la violence extrême qui caractérisent notre époque. L’exemple de la clinique des demandeurs d’asile amène l’auteur à discuter de la posture du clinicien et du réaménage- ment du dispositif, tous deux nécessaires à l’amorce d’un travail psychique dans le plus grand respect du sujet abîmé par l’ampleur (voire l’impensable) de la violence de l’autre.
Puis, dans un style très personnel, Anthony Bourgeault aborde la vio- lence à travers un récit qui évoque d’emblée l’associativité du monde oni- rique. Là où se rencontrent le sujet et sa pulsionnalité, l’œuvre de l’artiste, le climat planétaire de violence, l’auteur fait dialoguer une expérience sin- gulière avec la psychanalyse et la philosophie. Le lecteur est convié à une expérience de création, de l’ordre d’une rencontre intime avec l’auteur, au sortir de laquelle il demeure empreint d’un regard nouveau sur la violence, celle de l’autre, peut-être, mais vécue à travers soi.
Finalement, Daniel Lemler interpelle le lecteur, le clinicien concerné par la violence qui nous entoure, de façon plus proximale que jamais. L’urgence de se questionner et d’agir ressort du propos, lequel amène le lecteur à se sentir interpellé non seulement par la violence subie par l’autre, mais égale- ment par le devenir violent de l’autre, de soi.
Pour clore ce dossier, Robert C. Colin propose une typologie de la vio- lence « meurtrielle », cette violence destructrice, équivalente fantasmatique du meurtre. En contraste avec les auteurs précédents, c’est d’une violence discrète, parfois silencieuse, dont il est ici question. La description de cette violence est éclairée par des vignettes cliniques élaborées, de même que par des œuvres d’art classiques.
Trois articles constituent ensuite la rubrique Hétéros de ce numéro. Daniella Anguelli y aborde le contre-transfert dans une perspective à la fois historique et féminine (peut-être même, féministe). Puis, Sébastien Chapellon et Florian Houssier discutent des remaniements psychiques engendrés par l’immigration, dans une articulation entre considérations théoriques d’une part, et illustration par le récit de fiction d’autre part. Enfin, André Jacques présente une réflexion sur les liens entre cinéma et psychanalyse, sous l’angle du parallèle entre rêve et film, et surtout, en lien avec des soirées consacrées à la diffusion et la discussion psychanalytique d’œuvres cinématographiques.