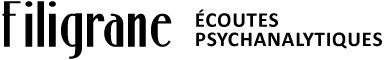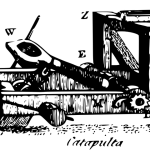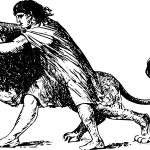Actes de colloque Le sujet sacrifié avec Ghyslain Lévy et de la journée clinique de la Société psychanalytique de Québec avec Catherine Chabert
Volume 25
Partie 1
Ce numéro thématique est issu d’un colloque de Filigrane (novembre 2015) intitulé Le sujet sacrifié ; violence dans la clinique. Nos auteurs abordent les concepts de violence et de sujet du point de vue psychanalytique, dans la perspective o. le clinicien se doit d’adopter une saine distance face . la violence qui s’insinue, de m.me que dans l’ensemble de la société, au coeur du cadre thérapeutique et de la rencontre inter-sujets qui s’y déploie. En ” mettant au travail ” cette violence, plutôt que de la nier ou de la faire sienne, en en cernant les tenants et les aboutissants, il semble que le clinicien serait notamment amené à l’intégrer à un travail véritablement thérapeutique et éthique avec les sujets qui le consultent. Répondant à l’argumentaire présenté en première partie de cette section thématique (Le sujet de la violence), les auteurs ci-dessous ont partagé au cours de ce colloque des réflexions issues de leur pratique clinique et de leur regard critique sur la société actuelle. Les différents articles proposés par Ghyslain Lévy s’organisent autour de l’hypothèse d’un principe d’indifférence considéré comme troisième principe aux fondements du fonctionnement psychique. En 1911, Freud avait distingué, dans ses formulations sur les deux principes du cours des évènements psychiques, un principe de plaisir-déplaisir et un principe de réalité Ne faudrait-il pas aujourd’hui s’interroger sur le primat d’un principe d’indifférence dont il s’agit d’avancer l’hypothèse au regard de l’importance d’une clinique de l’emprise qui s’origine, comme Freud le soulignait déjà, dans une forme d’indifférence envers l’objet et, plus globalement, envers le monde extérieur ? Un principe qui, au-delà. de la vie psychique singulière, s’étend aujourd’hui à l’ensemble, quand l’indifférence envers l’autre rejoint la simple annulation de son existence ? Un premier article de Ghyslain Lévy propose l’articulation de l’emprise actuelle du savoir technologique et de son pouvoir de mort. Il y est question de la place et du rôle à accorder à une pulsion cruelle qui, comme poussée d’emprise, vise la saisie de l’autre, son consentement passif, jusque dans ses formes fanatiques les plus régressives. Dans un second temps, l’auteur aborde, à partir de l’hypothèse du primat du principe d’indifférence, la question du transfert lorsque celui-ci se déploie dans une clinique de l’emprise et de l’auto-emprise. Dans un troisième temps, il s’agira pour lui de questionner le primat d’indifférence dans le contexte socioculturel comme condition de l’autosacrifice qui semble s’inscrire au coeur des nouvelles formes du sacré contemporain. Par la suite, Ellen Corin nous propose une élaboration sur la violence, située dans une fine intrication entre psyché et culture. Revenant à Freud et notamment à la pulsion de mort, l’auteure nous invite à considérer comment cette violence peut non seulement se discerner mais faire son oeuvre dans la clinique, dans la sphère collective notamment par le biais de l’image, puis sur la scène culturelle par les oeuvres écrites, et dans une diversité d’expressions artistiques, notamment par les arts visuels et la danse. Les propos de Ghyslain Lévy et d’Ellen Corin sont ensuite discutés au sein d’un texte de Laurence Branchereau, lequel amène le lecteur à situer à la fois les convergences et les divergences des propos. Par une réflexion au plus proche des points saillants de ces articles, Laurence Branchereau tend à soulever la complémentarité de la pensée de ces auteurs. En conclusion de ce dossier, l’articulation entre la violence et le sujet est abordée par Alexandre L’Archevêque et Élise Bourgeois-Guérin. La perspective des auteurs, fortement ancrée dans les différents constituants du cadre de la consultation clinique (la demande, la dynamique transférentielle, etc.), offre un point de vue complémentaire aux propos des auteurs précédents. En effet, la donne culturelle y constitue la toile de fond d’une élaboration aux multiples ancrages sur la violence inhérente au sujet, dans son rapport à lui-même, comme à l’autre incluant ici le clinicien. Finalement, l’article d’Emmanuel Piché offre au lecteur un approfondissement métapsychologique des réflexions d’Alexandre L’Archevêque et d’Élise Bourgeois-Guérin. Dans la mouvance de la clinique contemporaine, les questionnements soulevés par l’auteur sauront alimenter la réflexion des cliniciens sur l’inscription de la violence dans la rencontre de consultants considérés comme sujets à part entière.
**********
La seconde partie de ce numéro se déploie essentiellement autour de la pensée de Catherine Chabert. Plus précisément, quatre textes abordent la thématique du féminin, sous l’angle de la bisexualité et de la différence des sexes. En premier lieu, à la suite du passage de Catherine Chabert à Québec, en octobre 2015 à titre d’invitée de la Société psychanalytique de Québec, nous avons le plaisir de publier non seulement le texte de sa conférence, mais également le commentaire de celle-ci tel que rédigé par Louise Mercier. Puis, la réflexion inhérente à ces articles se poursuit et est habilement contextualisée dans une entrevue que Catherine Chabert a bien voulu accorder à Filigrane, par l’intermédiaire de Louise Mercier. Finalement, thème incontournable de ses récents écrits, la bisexualité psychique sera également abordée par Lise Marceau, dans une lecture critique du livre de Catherine Chabert intitulé Bisexualité et différence des sexes, au sein de notre rubrique Bouquinerie. Cette recension fut également présentée dans le cadre de la journée clinique organisée par la Société psychanalytique de Québec. Ce numéro de Filigrane se termine par notre rubrique “Psychanalyse à l’université ” ; Anaëlle Bazire et Nadine Proia-Lelouey y présentent les résultats d’une recherche clinique menée auprès de femmes enceintes toxicomanes. Il en ressort des considérations importantes pour les cliniciens appelés à travailler auprès de ces femmes aux prises avec des conflictualités psychiques trop souvent voilées sous l’ampleur des symptômes et la réalité de la naissance à venir.