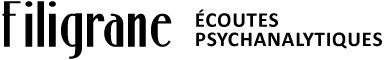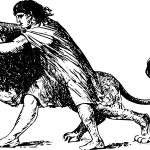La terreur des enfants
Volume 26
Partie 1
Après une brève introduction au thème de la « terreur des enfants », le dossier thématique s’amorce par deux articles tirés des présentations de conférenciers lors de notre colloque de l’automne 2016. En premier lieu, Maurice Berger aborde la violence exprimée par les adolescents, et surtout l’approche compréhensive développée au sein de son équipe de pédopsychiatrie. Sa vaste expérience clinique teinte son propos généreusement illustré, afin de présenter la pertinence de cibler le réinvestissement du fonctionnement intrapsychique auparavant voilé sous des agirs imposants. L’article de Sylvaine De Plaen témoigne aussi de l’ampleur de l’expérience clinique de l’auteure dans le domaine de la pédopsychiatrie. Toutefois, les cas présentés sont ici précédés d’une réflexion anthropologique qui permet de penser autrement la violence et l’agressivité, en les resituant non seulement dans les aléas du développement psychique et du système familial, mais également dans les racines historiques de l’humanité. Par la suite, Nicolas Peraldi aborde les racines de la « terreur » des enfants, sous l’angle de la fine jonction entre les considérations sociétales et la constitution de la psyché. Et si les tentatives de « gérer » la pulsionnalité ne pouvaient que mener à certaines aberrations, telles que les cliniciens en discernent les traces dans la teneur de leurs consultations ? À se demander qui terrorise qui – dans ce désir de museler l’enfant et l’expression de son désir, sa souffrance, son euphorie, voire même, sa sexualité. Pour clore ce dossier, Sophia Koukoui propose une approche originale de la violence des adolescents. En effet, si les failles de la symbolisation ont souvent été pointées du doigt pour expliquer la prégnance des agirs, il demeure que la référence à la phénoménologie, en particulier celle de Ricoeur, est plus inhabituelle chez les cliniciens d’orientation psychanalytique. Une illustration de la pertinence du récit de soi dans le travail clinique convaincra le lecteur de l’intérêt de telles assises théoriques, à l’heure où la question du récit en psychanalyse est de plus en plus d’actualité.
La rubrique Hétéros fait place à un article d’Alexandre Francisco qui présente des concepts phares de la psychanalyse, dont la symbolisation, pour ensuite en illustrer le caractère heuristique. Le cas présenté avec détail et finesse offre une riche matrice de réflexion pour les cliniciens. Ce numéro se termine, dans la rubrique Psychanalyse à l’Université, par un article tiré d’une recherche clinique menée par Emilia Racca et Anne-Valérie Mazoyer. Il s’agit d’une étude de cas qui illustre certains enjeux inconscients relatifs au non désir d’enfant tels que notamment dévoilés par des supports projectifs.