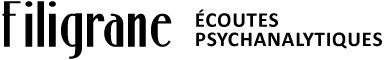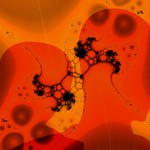Le devenir de la psychanalyse. Échos d’ici et d’ailleurs …
Août 31, 2015
Sophie Gilbert
Volume 24
Partie 1
Le devenir de la psychanalyse… Tel est le thème que nous élaborons depuis plus d’un an déjà, d’abord dans le cadre d’un colloque tenu à Montréal, puis au sein des dossiers thématiques de nos numéros de 2014. Si ces derniers ont permis aux […]...
lire toute la présentation
Le devenir de la psychanalyse… Tel est le thème que nous élaborons depuis plus d’un an déjà, d’abord dans le cadre d’un colloque tenu à Montréal, puis au sein des dossiers thématiques de nos numéros de 2014. Si ces derniers ont permis aux cliniciens, en particulier aux cliniciens québécois, de proposer plusieurs réponses à cette large question, nous avons rapidement constaté combien nos interrogations et préoccupations étaient fortement partagées, et ce, notamment de l’autre côté de l’Atlantique. Ainsi,
nous avons décidé de poursuivre cette importante réflexion en conviant plus particulièrement des auteurs d’outre-mer que nous savions intéressés par cette question quasi existentielle en ce qui concerne la psychanalyse. L’an dernier, les auteurs et conférenciers d’abord interpellés par cette thématique ont eu tôt fait d’aborder leur pratique institutionnelle, le défi posé par celle-ci dans ces lieux où clairement, la valeur — le plus souvent posée en termes « comptables » et non cliniques — de l’approche psychanalytique est régulièrement mise en doute. Ce mouvement réflexif a amené certains d’entre eux à cerner les fondamentaux de cette approche, proposant du même souffle un nouvel éclairage, voire même de nouvelles assises à ce qu’on pourrait envisager comme une pratique psychanalytique
hors cadre de la cure classique . Ces propositions sont apparues d’autant plus importantes de nos jours, que rares sont aujourd’hui les véritables demandes d’analyse — une réalité à relier non seulement aux milieux de formation et de pratique relatifs à la santé mentale (incluant la psychiatrie et la psychologie),
mais aussi à des considérations socioéconomiques et plus largement sans doute, socioculturelles. Malgré la richesse des deux précédents numéros, certaines questions sont restées en suspens, alors que d’autres interrogations ont émergé. Par exemple, si le travail du psychanalyste en institution a été à la fois évalué,
critiqué, et considéré sous l’angle de sa spécificité, qu’en est-il de cette institution où il s’inscrit ? Comment comprendre le fonctionnement et la dynamique de ce qui, plus qu’un lieu physique, est d’abord constitué d’un regroupement de soignants ? Plus encore, la médecine et plusieurs approches (dites «probantes») en psychologie semblent, du point de vue de la psychanalyse, faire concurrence à un savoir qui demande temps et investissement (dans tous les sens du terme), et qui a pour assises des concepts peu populaires (car marqueurs d’impossible, ce qui s’oppose à l’idéal contemporain de toute-puissance individuelle…) tels la subjectivité et l’inconscient. Qu’arrive-t-il lorsque l’on considère que la psychanalyse pourrait être non pas victime du contrôle scientifique d’allégeance médicale, mais plutôt partie intégrante d’une interinfluence entre deux lieux (différents, voire même opposés, mais qui s’alimentent l’un l’autre) de développement du savoir sur la psyché ? Enfin, au-delà de la notion actuelle d’une convergence de la psychopathologie vers les problématiques limites, les troubles narcissiques,
etc., au-delà de la critique quasi unanime du DSM V dans les milieux psychanalytiques et psychiatriques, la psychanalyse pourrait-elle soutenir encore aujourd’hui une nosographie heuristique pour les cliniciens? Y a-t-il lieu, après les insatisfactions générées par l’approfondissement (à l’extrême ?) d’une classification dite a-théorique, donc descriptive, de tout symptôme (y compris ceux qui témoignent davantage du caractère humain que d’une psychopathologie), de considérer un retour à une vision diagnostique sous l’angle dynamique et signifiant que propose la psychanalyse ? Un autre champ peu discuté précédemment est celui de l’inscription de la théorie et de la clinique psychanalytique dans l’Histoire. Pourtant, dès sa naissance, cette nouvelle discipline relative au fonctionnement psychique a été imprégnée par l’histoire sous différentes formes : les guerres, mais aussi, les penseurs contemporains et prédécesseurs de Freud. Que nous apprennent ces événements historico-culturels sur l’humain et comment cet apprentissage en constante évolution teinte-t-il les conceptions et pratiques de cliniciens d’orientation psychanalytique ? Cette question en amène une autre, plus fondamentale peut-être, face à laquelle l’on peut se demander si la psychanalyse a pris — ou peut-être éventuellement prendra — position: comment articuler la singularité du sujet de l’inconscient avec ce qui est plus globalement de l’ordre de l’humain ? En d’autres termes, comment l’historicité sous son jour événementiel, peut être (ou non) arrimée à une compréhension du fonctionnement intrapsychique propre à la psychanalyse
? Interrogation qui ouvre la voie à une réflexion sur la place occupée de nos jours par la psychanalyse dans la population, dans la culture, dans le regard porté sur l’actualité… Autant de questions auxquelles le lecteur pourra trouver des réponses, ou parfois des prémisses de celles-ci, dans les pages qui suivent.
***
Dans la foulée de ces réflexions de la dernière année, un colloque tenu à Bruxelles en mars 2014 aura retenu notre attention. Intitulé Modernité, scientificité et liens transférentiels : des oxymores ?, ce colloque avait pour but d’interroger « les modifications que le changement d’organisation du lien social […] induit sur le processus du subjectivation », à la fois chez les consultants et chez les soignants. Deux orateurs de ce colloque ont accepté de nous soumettre un article reprenant en partie les idées qu’ils ont introduites lors de cet événement*.
D’abord, Vassilis Kapsambelis développe une conceptualisation actuelle de l’« institution psychiatrique» à partir d’une définition qu’il analyse et de certains fondements qu’il situe dans l’histoire et le développement de la psychiatrie. Peu à peu se dégage une appréhension de l’institution en tant qu’organisme doté d’une pulsionnalité propre. En découle la présomption d’un transfert du patient envers l’institution ; une réflexion que l’auteur aura l’occasion de poursuivre dans un article subséquent.
Puis, Ariane Bazan aborde plus largement le domaine de la psychologie, mais dotée de lunettes psychanalytiques. L’auteure pose l’hypothèse que contrairement à ce qu’on peut observer dans les institutions, les cliniques, et le domaine de la psychiatrie en particulier, les progrès de la médecine,
de la physiologie, de la neuro-imagerie ne vont pas réduire la psychologie à un volet de la médecine, mais bien renforcer l’autonomie de la science de la psyché. En ce sens, un véritable « dualisme » est suggéré, où les sciences s’avèrent complémentaires et non réductibles l’une à l’autre, d’où l’apport de la recherche en psychanalyse pour comprendre le fonctionnement du sujet, corps et esprit.
Au sein de notre dossier thématique, ces textes sont suivis d’un article de François Duparc qui propose un retour à la conception freudienne de névroses actuelles afin de distinguer et d’articuler les solutions mélancoliques et somatiques à la dépression. Ce faisant, il martèle l’importance d’une nosologie en psychanalyse, puis encourage les cliniciens d’aujourd’hui à l’ouverture au plan du cadre du travail psychique psychanalytique, en liens avec certaines spécificités des pathologies-limites par lesquelles le corps, l’agir et les émotions sont mis en scène et appelés à être entendus.
***
Plus près de nous, ici à Montréal, se tenait au printemps 2014 le Congrès des psychanalystes de langue française. À cette occasion, la revue Filigrane a proposé à certains conférenciers de nous accorder une entrevue, menées par des psychanalystes québécois. Si ces entretiens sont disponibles en ligne, il nous est apparu pertinent d’en publier la transcription en complément à notre dossier. En effet, chacune de celles-ci démontre à quel point la psychanalyse est bien vivante aux quatre coins du monde, notamment en Israël, en France et en Espagne. Une psychanalyse en évolution constante aux plans théorique et clinique, mais tout de même fidèle à certaines assises freudiennes dont la relecture attentive (et contextualisée) permet de saisir la richesse. Dans ce cadre, Viviane Chetrit-Vatine nous transporte sur le territoire de l’inter-humain, plus précisément celui de la capacité de responsabilité pour l’autre, héritage du maternel (comme fonction, non relié au genre). Il s’ensuit une élaboration sur la place du maternel dans la psychanalyse d’aujourd’hui, en tant que fonction complémentaire à la fonction paternelle (notamment au regard de l’articulation entre éthique et loi), mais aussi, en tant que tributaire du lien féminin-maternel — à distinguer de la propension généralisée à cliver la femme et la mère.
Laurence Kahn nous propose une riche entrevue où s’enchevêtrent le retour sur son histoire, sa formation et ses précieux apports théoriques, de même que l’évolution de la théorie freudienne, au regard de l’Histoire (et de ses apories), de la civilisation (et de ses progrès) dans laquelle celle-ci a pris
naissance. De nouveau, c’est ici un retour à la compréhension, par la psychanalyse, de l’humain (à commencer par l’«humanité » de Freud, l’homme, avant d’être le scientifique que l’on connaît), de son fonctionnement, qui est à l’œuvre. En particulier, Madame Kahn s’attarde à ce qui de la théorie freudienne, sujette à une lecture critique et attentive, rejoint la clinique d’aujourd’hui, adressée à différentes populations, et déployée dans divers cadre du travail analytique. La question se pose alors: pourquoi les dérives, non seulement de la psychiatrie, mais d’abord de certaines formes de « psychanalyses » actuelles, considérant la richesse de ces fondements ? Finalement, Mikel Zubiri nous présente, après un détour sur la naissance et l’évolution des sociétés psychanalytiques d’Espagne, les spécificités du travail et de la formation psychanalytique en psychosomatique. Au détour de cet entretien, la controverse autour de l’utilisation des nouvelles technologies par les psychanalystes est notamment soulevée : peut-on aujourd’hui, comme clinicien, s’imaginer faire totalement fi de la voie « écrite » à peine différée, telle que véhiculée par les voies du web ?
***
Notre rubrique psychanalyse à l’université témoigne de nouveau de cette vitalité du monde psychanalytique. Irène Krymko-Bleton y présente une méthode d’analyse de dessins utilisée en recherche empirique qualitative d’orientation psychanalytique. Cette modalité de la recherche à l’université s’avère l’occasion de discuter d’une part, des développements actuels de l’interprétation du dessin d’enfant et d’autre part, des liens à tisser, voire à consolider entre recherche et clinique en psychanalyse. Nous terminons ce numéro avec deux brefs articles de notre rubrique Échos, lesquels font place à une réflexion ancrée dans le vécu singulier des auteurs. D’une part, une expérience récente en cabinet privé, là où un événement en apparence anodin amène à cerner les assises de la position contre-
transférentielle du clinicien (Karine Roy-Déry). D’autre part, l’expérience marquante de jadis, celle d’un Lacan connu de l’intérieur, un Lacan plus humain que mythique (Jean Fourton). Quelle heureuse façon de conclure ce numéro sur la psychanalyse d’aujourd’hui, là où les concepts, la métapsychologie, la technique spécifique n’a pas honte de dévoiler l’humanité du psychanalyste, de la psychanalyse. N’est-ce pas la plus belle qualité que quiconque puisse revendiquer, fût-il analyste ?
Notes
* Nous remercions chaleureusement madame Alice Bytebier qui a permis ce lien avec les conférenciers.