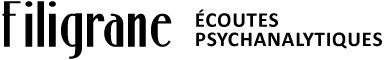La psychanalyse est un dispositif de mise en scène d’un sujet. D’une part, la psychanalyse est un dispositif de mise en conscience et de mise en lien. Malgré les empreintes de ses origines qui la supportent et la freinent, elle soutient un processus hors des temps chronologiques, des espaces culturels et des pathologies spécifiques. D’autre part, la psychanalyse est un instrument de mise en question et de mise en jeu. Elle interroge et relance les réalités et leurs sens, les vécus et leurs origines, les crises et leurs fonctions. Du même souffle, ses théories et ses pratiques sont mises à l’épreuve, en dégageant les premières du risque de conservatisme et en préservant les deuxièmes du danger de dispersion. Et puis, la psychanalyse est un outil de création, de mise en oeuvre. Elle place deux sujets là où tout peut s’avérer nouveau et imprévu. Elle peut apporter à tous les thérapeutes, au-delà des différents modèles thérapeutiques, une lucidité et une liberté dans l’exercice de leur fonction.
Dans ce travail, nous traitons des deux limites de la temporalité que sont l’archaïque d’une part et la mort d’autre part. Le chemin parcouru entre les deux constitue le projet identificatoire. L’archaïque s’organise sur l’espace originaire et s’illustre selon deux potentialités que sont la potentialité mélancolique et la potentialité paranoïaque. La mort demeure une sérieuse énigme pour le sujet dont les contours sont peut-être en train de se modifier à l’heure actuelle. Le projet identificatoire se structure sur la base de l’identification primaire à double composante d’identification symbolique, qui préexiste au sujet, et d’identification narcissique, qui en marque l’origine historique. Notre propos se termine par un questionnement sur la problématique ouverte par les nouveaux processus de subjectivation.
L’inconscient freudien se caractérise d’être inextricablement lié à la notion de trace, une trace qui s’inscrit dans l’expérience vécue. Cette trace ne s’efface pas et nous la retrouvons dans les signifiants qui émaillent le discours, les actes psychiques tels le rêve, les symptômes, les actes d’un sujet. Ce qui s’est inscrit s’avère inaltérable sous l’action du temps. À l’aune de cette notion, l’inscription d’une trace, que deviennent la mémoire et nos souvenirs ?
L’auteur propose ici une « étude », c’est-à-dire une exploration de la concordance et de la différence qui peut exister entre, d’une part, la conception énactive de la perception en philosophie de l’esprit (Alva Noë) et, d’autre part, la conception métapsychologique de la perception de l’autre humain, qui va du Projet de Freud à la théorie de la séduction généralisée de Laplanche. Par cette mise en parallèle de deux théories de la perception, l’auteur croit pouvoir étayer une proposition concernant la temporalité particulière de l’inconscient : un temps « actuel ». C’est une proposition dont il a commencé l’élaboration il y a quelques années et qu’il poursuit ici sous un nouvel angle.
Voyager entre Charybde et Scylla. L’expression homérique est connue. Entre les écueils souvent acérés des demandes qui leur sont adressées et la tempête de la subjectivation, les jeunes pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance doivent se mesurer à deux temps, l’un social, l’autre psychique. L’un et l’autre ne suivant pas le même rythme. C’est dans ces mouvements que l’auteur essaie de penser avec ces jeunes sur leurs errements, et ce en fonction des décisions qui interviennent
dans la direction de la cure.
À propos de Filigrane
CHAQUE ANNÉE UN THÈME D'ACTUALITÉ EST ABORDÉ DANS LE DOSSIER, RÉPARTI AU SEIN DE DEUX NUMÉROS